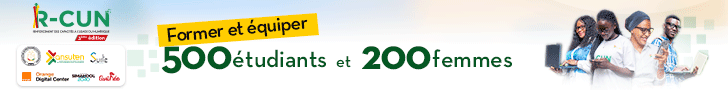Mettant leur menace à exécution, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé, ce lundi 22 septembre, leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI). Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une série de mesures à tonalité souverainiste adoptées par ces trois pays dirigés par des militaires depuis leur rupture avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qu’ils accusaient déjà d’être inféodée à des puissances extérieures. Mais concernant spécifiquement la CPI, ce retrait ressemble davantage à une récupération politique des critiques récurrentes qui visent la juridiction internationale, plutôt qu’à une réaction à un contentieux précis. En effet, hormis les dénonciations souvent entendues reprochant à la Cour de concentrer l’essentiel de ses poursuites sur des dirigeants africains, on peine à identifier des raisons concrètes qui justifieraient ce désengagement spectaculaire.
En effet, à première vue, aucun dirigeant du Mali, du Burkina Faso ou du Niger n’était ciblé par une procédure en cours devant la CPI. De même, aucun de ces pays n’avait déposé de plainte contre un autre Etat ou de présumés criminels qui aurait été ignorée ou traitée avec légèreté par l’institution basée à La Haye. Certes, plusieurs ONG de défense des droits humains ont, ces dernières années, dénoncé des exactions imputées notamment aux forces armées maliennes et burkinabè, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais jusqu’ici, aucune de ces accusations n’a débouché sur une procédure judiciaire internationale.
La démarche des pays de l’AES semble donc moins répondre à une nécessité juridique qu’à une stratégie politique. En se retirant de la CPI, Bamako, Ouagadougou et Niamey surfent sur une vague de contestation grandissante de l’institution. Celle-ci est critiquée depuis sa création en 2002 pour son « deux poids, deux mesures », accusée de se focaliser quasi exclusivement sur l’Afrique, tandis que des crimes commis ailleurs dans le monde échapperaient à son champ d’action.
Ces dernières années, la Cour est également entrée dans la tourmente face à des puissances majeures. Aux Etats-Unis, Donald Trump n’a jamais caché son hostilité envers la CPI, allant jusqu’à sanctionner certains de ses magistrats lorsque des enquêtes visaient l’armée américaine en Afghanistan. Plus récemment, les mandats d’arrêt délivrés contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou contre le président russe Vladimir Poutine ont accentué les tensions, alimentant les accusations de partialité et de politisation.
C’est dans ce contexte déjà défavorable que les régimes du Sahel ont choisi leur moment. Leur retrait peut être lu comme une façon de s’aligner sur une rhétorique ambiante de contestation de la CPI, tout en se protégeant, par précaution, d’éventuelles poursuites futures. Il n’est pas exclu que la crainte de voir un jour certaines exactions documentées par les ONG parvenir jusqu’à La Haye ait également motivé cette décision.
Enfin, sur le plan diplomatique, cette rupture leur permet d’entretenir l’idée qu’ils demeurent fidèles à la doctrine de rejet de toute ingérence extérieure et d’une affirmation de souveraineté totale. Ce qui peut se capitaliser politiquement auprès des opinions publiques dans les trois pays. Le geste s’inscrit dans la même logique que leur divorce avec la CEDEAO. Quitter la CPI devient ainsi un symbole de résistance et de cohérence idéologique, plus qu’une nécessité juridique.
Finalement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se contentent pas de tourner le dos à une juridiction internationale. Leur annonce revêt également une dimension éminemment politique. En effet, par les temps qui courent, le bras de fer avec une certaine communauté internationale peut apparaître comme une recette miracle. A condition toutefois de ne pas en abuser.
Boubacar Sanso Barry