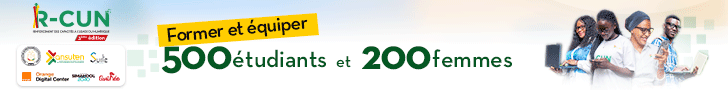De nouveau, l’Europe et l’Afrique se retrouvent réunies depuis ce lundi 24 novembre en Angola pour faire l’état des lieux de leur coopération et tenter d’esquisser les contours d’un nouveau partenariat, dans un contexte de bouleversements sans précédent des deux côtés de la Méditerranée. Alors que le Vieux Continent, plus que jamais miné par la montée des nationalismes, est fragilisé par les infidélités géopolitiques de l’Amérique de Donald Trump, l’Afrique, elle, se découvre des alternatives de plus en plus crédibles avec les Russes, les Chinois, les Indiens, les Turcs ou encore les pays du Golfe. Un rapport de forces qui place le continent africain en meilleure posture pour négocier. Autrement dit, entre Africains et Européens, les relations sont appelées à se réinventer — non par choix, mais par nécessité imposée par la nouvelle donne mondiale. Reste à savoir si les populations, au sud, en seront réellement bénéficiaires. Ce n’est pas garanti, du moins pas pour tous.
Dans les couloirs du 7ᵉ sommet Union africaine–Union européenne, ouvert hier à Luanda, un même leitmotiv revient : sortir des grandes déclarations, dépasser les promesses ambitieuses mais rarement concrétisées, et passer enfin aux actes. C’est le principal grief formulé par l’Afrique à l’égard de l’Europe. À la différence de la Chine, qui construit routes, ponts et bâtiments, l’Union européenne a longtemps multiplié les engagements sans toujours leur donner corps. À cela s’ajoute le débat, récurrent, sur les valeurs démocratiques, les droits humains et les libertés. Autant de questions perçues par plusieurs dirigeants africains comme une ingérence dans les affaires intérieures ou comme une attitude condescendante qui les renverrait à un statut de mineurs politiques.
Malgré ces points de friction, l’Afrique et l’Europe ont jusqu’ici maintenu une relation solide, faisant de l’Union européenne le premier partenaire commercial du continent. Mais de nouveaux défis apparaissent clairement. Certes, la proximité géographique et l’histoire coloniale ont noué des liens profonds entre les deux blocs. Toutefois, les évolutions actuelles pourraient remettre en cause les relations africano-européennes telles qu’on les a connues. Face aux appétits croissants d’autres puissances, l’Europe ne semble plus disposer des ressources suffisantes pour suivre le rythme. Dans le même temps, l’arrivée possible de gouvernements d’extrême droite dans plusieurs pays européens pourrait redéfinir radicalement l’approche européenne de l’Afrique. Du côté africain, la multiplication des coups d’État ces dernières années a propulsé au pouvoir des dirigeants qui se veulent les chantres d’une défiance assumée à l’égard de l’Europe. Une défiance qui, bien souvent, dissimule un souverainisme de façade servant surtout de levier à des régimes cherchant à échapper à toute forme de reddition de comptes.
Les projections les plus réalistes laissent entrevoir un scénario dans lequel les Européens, s’alignant progressivement sur les pratiques russes et chinoises, pourraient mettre entre parenthèses leurs discours sur la démocratie ou les droits humains, pour se concentrer exclusivement sur les enjeux commerciaux et économiques. Un schéma qui, à première vue, pourrait sembler plus respectueux de la souveraineté africaine. Mais il ne sera viable que si les dirigeants africains se montrent à la hauteur des responsabilités qui leur incombent. Dans le cas contraire, le risque est grand de voir cette évolution se solder par un échec retentissant, dont l’une des manifestations les plus visibles serait une aggravation de la crise migratoire.
Finalement, l’avenir des relations euro-africaines dépendra moins des déclarations de sommet que de la capacité des deux continents à accepter que le monde a changé et à s’y adapter sans renoncer à leurs principes. Car dans la compétition géopolitique qui s’installe, ceux qui tardent à se repositionner risquent de perdre bien davantage que des parts de marché.
Boubacar Sanso Barry