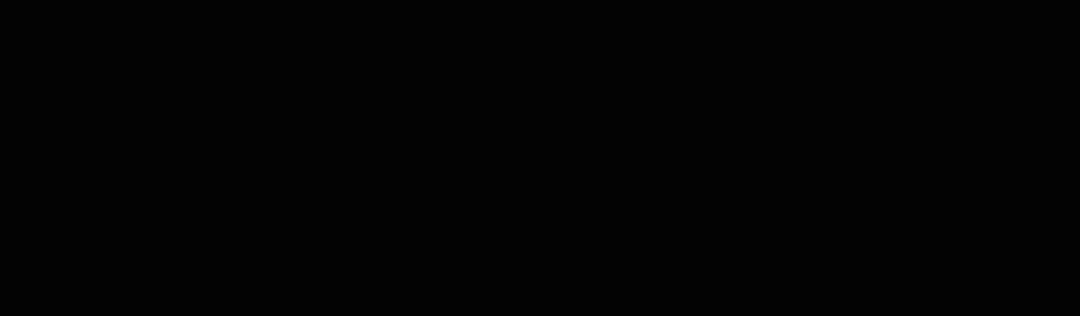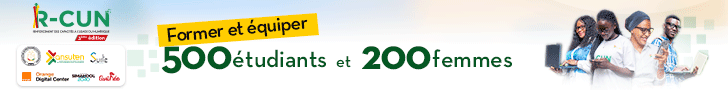Le procès de l’ancien président congolais, Joseph Kabila, qui se tient depuis le 25 juillet dernier devant la Haute Cour militaire de Kinshasa, était jusqu’ici relativement terne. Mais la réquisition du ministère public, formulée le vendredi 22 août, avec à la clé la demande de la peine capitale contre l’ex-chef de l’Etat, a relancé l’intérêt bien au-delà des frontières de la RDC. Car à travers cette réquisition, on prend soudain conscience de la détermination avec laquelle les autorités congolaises veulent infliger à Kabila une sanction exemplaire. Mais une question demeure : que gagnera réellement le pays dans une telle issue ? Le verdict attendu incarnera-t-il enfin la rupture que les Congolais appellent de leurs vœux pour responsabiliser leur classe politique ? Ou, au contraire, viendra-t-il attiser des braises encore fumantes dans un pays habitué à l’instabilité et aux affrontements aux relents à la fois communautaires, politiques et économiques ? Les deux scénarios restent plausibles.
Une complicité active avec les agresseurs
Il est vrai qu’au regard de sa gouvernance depuis six ans, le président Félix Tshisekedi ne fait guère mieux que ses prédécesseurs. Mais on ne saurait lui reprocher ce procès. D’abord parce que Joseph Kabila lui-même n’a rien fait pour l’éviter. Dans la foulée de l’agression intense subie par le pays entre décembre 2024 et février 2025, de la part de la rébellion de l’AFC/M23 soutenue par le Rwanda, l’ancien président, loin de s’inscrire dans une dynamique de résistance, a semblé vouloir exploiter cette période de crise à des fins politiques. Pire, son attitude a laissé transparaître, à plusieurs égards, une complicité active avec les agresseurs. Son séjour, il y a quelques mois, dans la ville de Goma alors contrôlée par les forces ennemies, en reste l’illustration la plus frappante. Un tel comportement dépasse le cadre d’une opposition politique et a, de fait, porté atteinte à des vies congolaises. Plus largement, cette posture illustre les dérives d’une classe politique obnubilée par ses intérêts personnels et mercantiles. Nombre de ses acteurs n’hésitant pas à financer des rébellions pour acquérir une influence que leurs seules idées ne pouvaient leur assurer. Si le verdict contre Joseph Kabila devait contribuer à mettre un terme à ce banditisme politique, il n’aurait pas été vain. Surtout que ce Kabila-là, en 2018, n’avait dû consentir à quitter le pouvoir qu’en contrepartie d’un deal politique qui avait pris en otage le suffrage des Congolais
Mosaïque d’ethnies peinant à faire nation
Mais la question est de savoir si l’Etat congolais dispose de la solidité nécessaire pour porter une telle rupture. Interrogation d’autant plus pertinente que la RDC vit depuis son indépendance sous le signe d’une instabilité chronique. Mosaïque de cultures et d’ethnies peinant à faire nation, le pays, pourtant richement doté en ressources, voit ses atouts se transformer en handicaps, attisant les manipulations de toutes sortes. Dans ce contexte, une lourde condamnation contre Joseph Kabila pourrait provoquer une déchirure aussi bien sociale que politique. Et l’ancien président pourrait se servir des tensions engendrées comme d’un prétexte pour relancer les hostilités, que les médiations américaine et qatarienne tentent laborieusement d’apaiser. Face au désœuvrement et à la précarité d’une jeunesse prompte à basculer dans des alliances politiques fragiles et changeantes, le président Tshisekedi aurait tort de se croire invulnérable. D’autant plus que l’armée congolaise a déjà montré, lors des batailles décisives, qu’elle ne constituait pas une force sur laquelle le pays pouvait véritablement compter.
Un tournant ? Seulement à certaines conditions
En définitive, le procès de Joseph Kabila peut véritablement marquer un tournant pour la RDC. Mais cela suppose certaines conditions. D’abord, la peine de mort n’est pas indispensable pour que le message passe. Ensuite, l’appui de la communauté internationale sera crucial afin d’empêcher l’ancien président, s’il en nourrissait l’intention, de se lancer dans une nouvelle aventure guerrière. Par-dessus tout, un travail de pédagogie devra être mené au niveau national, pour permettre aux populations de saisir la portée symbolique de ce procès. Encore faut-il que les autorités elles-mêmes s’engagent réellement dans la dynamique de rupture qu’elles prétendent incarner, faute de quoi l’occasion risquerait d’être manquée.
Boubacar Sanso Barry