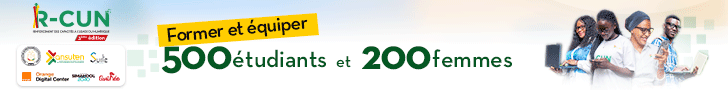Il est vrai que les événements dont Antananarivo, la capitale malgache, a été le théâtre ce mardi 14 octobre, marquent un tournant dans l’histoire de la Grande Île. Mais, à l’échelle de l’actualité politique du continent africain de ces dernières années, ils n’ont rien de véritablement inédit. Un président en rupture avec son peuple, contraint d’abandonner le pouvoir mais tentant encore de s’y accrocher contre toute évidence ; des militaires qui, profitant d’une lutte de longue haleine, s’improvisent en sauveurs de la nation : ces images-là, nous ne les connaissons que trop bien. Et, franchement, elles ne nous laissent pas toujours de bons souvenirs. C’est dire que les Malgaches devraient, pendant qu’il est encore temps, éviter de tomber de Charybde en Scylla. Au contraire, ils gagneraient à mettre à profit l’intermède politique qui s’ouvre pour s’atteler à la mise en place d’institutions solides, capables de mettre fin à cette instabilité chronique. Car c’est bien là le déficit structurel qui explique en grande partie cette nouvelle crise.
D’une certaine façon, le ciel s’est enfin éclairci au-dessus de Madagascar ce 14 octobre. Certes, depuis samedi dernier, le ralliement de l’unité d’élite du CAPSAT au Collectif Gen Z avait déjà scellé le sort du président Andry Rajoelina. Mais c’est véritablement ce mardi que sa chute est devenue irréversible. Toutefois, ce énième changement anticonstitutionnel à la tête d’un Etat africain, au-delà des scènes de liesse populaire qui nous parviennent de Tana et d’ailleurs, devrait pousser à une réflexion profonde sur la vulnérabilité persistante de nos régimes politiques.
La comparaison avec la crise politique qui paralyse actuellement la France s’impose. Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, le pays de Macron vit une instabilité politique sans précédent. Pourtant, jamais l’idée d’un renversement du président n’a effleuré quiconque, tant les institutions françaises demeurent solides et respectées. A l’inverse, à Madagascar, en à peine trois semaines d’une crise née d’une simple revendication pour une meilleure desserte en eau et en électricité, le régime s’est effondré.
La raison ? La fragilité des institutions. Ces dernières, souvent bâties sur des logiques clientélistes et partisanes, sont davantage inféodées au dirigeant qu’à la nation. Ceux qui les composent ne sont pas toujours portés par la conviction, ni par un suffrage véritablement représentatif. Leurs nominations résultent souvent d’arrangements d’arrière-boutique, les prédisposant à servir le président plutôt que le pays. Dépourvues de légitimité et de la confiance populaire, ces institutions se révèlent incapables d’assumer les missions qui devraient garantir la stabilité nationale.
Une autre explication de la chute vertigineuse du régime d’Andry Rajoelina réside dans le décalage entre les aspirations des Malgaches et le désintérêt flagrant du pouvoir à leur égard. Cette fracture se traduit par un constat accablant : en 2025, dans la capitale même, l’eau et l’électricité demeurent des denrées rares, presque luxueuses. Pour un président qui, il y a plus de quinze ans, avait conquis le pouvoir au nom de la lutte contre l’incurie de son prédécesseur, c’est tout simplement inacceptable. D’autant que ce n’est pas seulement une question de moyens, mais de volonté politique. Les dirigeants malgaches, comme tant d’autres sur le continent, ont préféré s’enfermer dans une conception jouissive et personnelle du pouvoir, oubliant que la politique devrait avant tout rimer avec responsabilité collective.
La crise malgache n’est donc qu’un épisode de plus dans la série des convulsions africaines. Parce qu’elle est le symptôme d’une pathologie profonde, à savoir celle d’Etats fragiles, minés par la personnalisation du pouvoir et l’érosion de la légitimité institutionnelle. Si Madagascar veut rompre ce cycle, elle devra réapprendre à bâtir des institutions fortes, crédibles et véritablement au service du peuple. Mais cette prescription est en réalité destinée à bien d’autres Etats africains.
Boubacar Sanso Barry