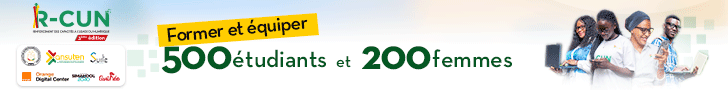Entre échos du passé et vibrations du présent, Moussa Doumbouya, alias Petit Tonton, nous plonge au cœur de l’histoire du conte africain. De la scène aux veillées populaires, de la transmission des valeurs ancestrales aux défis de l’ère numérique, il démontre comment cet art intemporel continue de façonner l’imaginaire des Guinéens… et bien au-delà. À l’aube de la 6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte, prévue le 5 décembre, découvrez l’artiste qui fait revivre nos histoires, nos racines et notre culture avec une modernité surprenante.
Lisez !
Ledjely.com : Vous êtes artiste, comédien et metteur en scène. Mais on vous sent particulièrement marqué par le conte. Pourquoi un tel choix ?
Petit Tonton : Mon histoire avec le conte vient des Jeux de la Francophonie, les huitièmes Jeux de la Francophonie, où j’ai représenté la Guinée. Et je suis revenu avec la médaille d’argent. Cette période tombe à un moment où je me posais des questions sur mon engagement en tant qu’artiste.
À l’époque, je me disais : est-ce que je suis en train de contribuer à valoriser notre culture ? Est-ce que je fais la promotion de la culture africaine en général et guinéenne en particulier ? Et je découvre que le conte est l’école de la vie dans la tradition africaine, que c’est un élément essentiel de notre culture. Et ces phrases m’interpellent et me touchent à tel point que je commence tout de suite ma reconversion. Et je découvre, au fil des ans, que le cinéma s’inspire du conte, le théâtre s’inspire du conte, la musique s’inspire du conte, que beaucoup de disciplines artistiques s’en inspirent.
Et je me suis dit : si j’ai eu une médaille dans cette discipline, à une telle compétition, c’est que peut-être j’ai quelque chose à exploiter là-dedans. Et c’est à partir de là que je commence à faire des recherches, à discuter avec les anciens. Comme c’est un élément culturel traditionnel, il faut aller à la source. Et la source, ce sont les anciens. Et je découvre qu’il y a une rupture d’échanges intergénérationnels, et cela fait que nous nous retrouvons avec des populations aujourd’hui qui ignorent, ou en tout cas qui minimisent, des valeurs essentielles. Des valeurs comme le respect de la parole donnée, le respect de la dignité, le respect de l’autre, la solidarité, l’amour, etc.
Et donc, à partir de là, je me dis : non, c’est ce que je veux faire maintenant. Parce qu’avant, je disais : je ne vais jamais arrêter de faire du théâtre. Mais quand je découvre tout ça, dans le conte, je dis : c’est ce que je veux faire maintenant.

Et comme c’est ce que je veux faire maintenant, et que j’ai fait du théâtre depuis plusieurs années, que j’ai fait de la mise en scène, que j’ai travaillé avec les cirques et la danse, j’utilise, je mets toutes ces expériences au service du conte.
Et en tant qu’ambassadeur du conte, quelles sont les missions que vous vous assignez ?
Je ne peux pas éviter la mission principale du conteur, qui est celle de passeur de mémoire, du passeur d’histoires, de celui qui reflète l’image de la société. C’est-à-dire que, comme le conte est le miroir de la société, il interpelle celle-ci sur certaines questions. Ce n’est pas pour autant un donneur de leçons.
Ce n’est pas parce que le conteur donne une leçon de morale, ou essaie de le faire à la fin de chaque conte, que c’est un donneur de leçons. Non, c’est celui qui expose les faits. Comme tout artiste.
Mais c’est aussi, et surtout, celui qui permet aux humains, à l’auditoire, de découvrir ou redécouvrir certaines choses. Pour les enfants, ma mission, c’est de leur faire découvrir les émotions, les états d’âme. C’est-à-dire que, dans un conte, je vais faire découvrir la peur à travers des personnages. Comment fait-on pour avoir du courage ? Donc, donner ces clés aux enfants. Pour les adultes, il s’agit de leur rappeler les mêmes valeurs humaines qu’on apprend aux enfants, mais aussi de les interpeller sur certaines choses. Et c’est le travail que je fais souvent dans mes spectacles : actualiser les contes d’antan, les contes populaires.
Et c’est mon côté metteur en scène qui me permet aussi de faire ce travail d’une manière professionnelle. Donc, c’est une mission de transmission de valeurs, d’interpellation, et même, parfois, de choc pour conscientiser.
Quelle est la place du conte dans notre monde aujourd’hui, où il y a les réseaux sociaux, les smartphones, l’intelligence artificielle, les dessins animés auxquels les enfants, et même tout le monde, ont accès ?
On va dire que le conte traditionnel, comme on l’imagine, parce que dès qu’on dit conte, on pense au feu de camp, à l’arbre à palabres, si on reste dans cette conception, on va dire qu’il n’a plus de place.
Mais si on essaie de l’adapter, de l’actualiser, de le réinventer, on va dire qu’il occupe aujourd’hui une grande place. Parce que, quand on va chez les anglophones, le storytelling, raconter, conter, c’est très à la mode. Pour présenter un produit, ils vont conter, ils vont faire du storytelling.
Les politiciens vont faire du storytelling. Les imams, dans les prêches et les sermons, utilisent des contes, ils racontent des contes et des légendes. Les prêtres aussi, pareil.
Donc, si on prend la forme du conte réinventé, elle est en train d’occuper une grande place, même dans les dessins animés, même dans l’intelligence artificielle aujourd’hui. Les gens utilisent de plus en plus l’IA pour créer des dessins animés inspirés de nos contes. On inaugurait une station d’intelligence artificielle il y a quelques semaines, et l’exemple, c’était quoi ? C’était de raconter, par l’intelligence artificielle, l’histoire de Samory Touré.
Il y en a qui ont dit l’histoire de Samory Touré, d’autres celle d’Alpha Yaya. Et donc, ils ont mis sur la plateforme l’histoire d’Almamy Samory Touré, avec les codes qu’il faut, etc., et avec une voix de conteur.

Donc, oui, la forme réinventée est en train d’occuper beaucoup de place, parce qu’aujourd’hui, si je prends le cas de Conakry, de la Guinée, moi personnellement, j’ai de plus en plus de demandes de contes dans des événements. Une entreprise fête ses 20 ans, 30 ans, elle va me demander de raconter l’histoire. Pour présenter un produit, on me demande de conter son histoire, mais traditionnellement.
Il y a un projet de remise de dons, on me demande de raconter une histoire. Et ça veut dire que le travail que les uns et les autres sont en train de faire redonne vraiment de la place aux contes.
Alors, quand on dit, en Guinée, « petit tonton », de plus en plus, on l’associe à un événement : la Grande Nuit du Conte, que vous avez organisée depuis pratiquement six ans. Quel sens donnez-vous à cet événement ?
L’idée de la Grande Nuit du Contes vient d’une formule plus réduite. Ça s’appelait le Café des Conteurs.
Le Café des Conteurs, c’était pour nous une façon de rappeler ou de ramener les veillées de contes qui se faisaient au village, et même un peu plus bas, même dans la cellule familiale. C’est-à-dire que le soir, quand le papa ou la maman, ou la tante, ou le grand-père, la grand-mère réunissaient la famille pour faire des contes.
On voulait ramener cela. Et on a commencé d’ailleurs par ça, par cette formule, dans une cour avec une dizaine, une vingtaine de personnes. Ensuite, on a cherché des moyens pour ramener les gens, peut-être à travers la musique, à travers la nourriture.
En Guinée, on aime tous le fouti (lafidi). Le fouti, donc, on aime l’odeur du soumbara. Donc, on aménage l’espace avec des nattes et des coussins, comme ça se fait à la maison ou au village.
On va inviter les gens. On va leur dire qu’il y a du lafidi le soir. Ils vont venir trouver une dame qui prépare du lafidi dans le décor.
Donc, ils viennent pour le lafidi et découvrent le conte. Ils viennent pour du bissap servies dans des calebasses, ils découvrent le conte. Et petit à petit, ça prend.
Ensuite, on s’est dit qu’il faut transporter le conte dans le milieu « élitiste ou VIP ». Mais pour cela, il faut trouver cette nouvelle cible là où elle est censé se réunir. Parce qu’encore une fois, j’apprends par les aînés que le conte s’invite partout où les gens se réunissent (dans les baptêmes, les mariages, toutes les cérémonies). C’est ainsi qu’on s’est dit : on va aller investir la cour d’un hôtel, faire une scénographie et proposer notre soirée conte. Et on va l’appeler la Grande Nuit du Conte.
Une nuit au cours de laquelle on va partager la parole. On va inviter d’autres conteurs africains à venir partager la parole. On l’a proposée la première fois, et Dieu nous a aidés à travers plusieurs choses.
La première édition, traditionnellement, comme ça se fait, moi je ne suis pas griot, et pour un tel événement, je n’avais pas traditionnellement la légitimité de l’organiser. Qu’est-ce que je fais ? J’attache dix noix de cola, je vais voir ceux qui ont la légitimité, pour leur demander la parole et les inviter à venir nous confier la parole et nous autoriser à l’organiser. Qui ? Je suis allé voir Mory Kanté (paix à son âme). Avec dix noix de cola, je lui ai expliqué. Pour deux choses : parce que c’est un griot et parce qu’il venait de faire un travail sur le conte qui s’appelle Cocorico. Il venait de sortir un album conte qui avait été primé à la SACEM. Donc je suis allé le voir pour dire que moi aussi je suis conteur, on veut organiser une Grande Nuit du Conte, mais on ne peut pas sans votre bénédiction, et donc il accepte.
C’est ainsi que ça a tout de suite pris. La deuxième édition, les tickets se sont vendus très vite, etc. Donc c’était pour nous de l’amener à un autre niveau, puisqu’on avait déjà réussi à avoir les gens dans les quartiers. Et après trois éditions, on se dit : ok, on a une certaine catégorie de public, donc des jeunes entrepreneurs, des chefs d’entreprise, même des ministres, etc. On va revenir encore à la base.
Et donc, avant la Grande Nuit du Conte, on va organiser des grandes veillées dans les quartiers, gratuitement, pour ne pas perdre le côté social, pour que les gens ne pensent pas que c’est un événement réservé à une certaine classe sociale. Et donc on va permettre à cette classe qui paye les tickets et à ceux des quartiers de vivre la même magie gratuitement. D’où la naissance des grandes veillées à partir de la quatrième édition.

Donc, on utilisait les réseaux sociaux pour lancer un challenge. On dit : « Mettez le nom de votre quartier, les trois quartiers les plus cités recevront une grande veillée gratuitement ». Et on organise en partenariat, ou en tout cas en collaboration avec les jeunes de ces quartiers, dans des espaces où ils aiment se réunir pour jouer au foot, ou pour organiser des Namougny Faré (danse traditionnelle), etc.
Et ce succès, qu’est-ce qu’il vous dit ?
Déjà, c’est un sentiment de satisfaction. Parce que cette adhésion autour de cet évènement nous prouve qu’on n’a pas eu tort d’initier ce projet. Surtout que l’idée commence à entrer dans le quotidien des gens.
Mais ça aussi, c’est notre challenge. Car, chaque édition génère de nouveaux défis. Et la question du nombre de places revient tout le temps.
Depuis le départ, on était sur 350 places. Pourquoi ? Parce que la parole et le conte sont bien quand c’est intimiste, quand les gens sont proches. Dès que les gens sont loin, ils se déconnectent de la parole. C’est vrai que si on élargissait à 500, on pourrait aller jusqu’à 1000 places. On ferait des recettes, mais l’événement perdrait en qualité. Donc le défi, c’est de pouvoir tenir cela : tenir la qualité de l’événement et se renouveler chaque fois artistiquement. Chaque année, qu’est-ce qu’on va proposer ? Qui va-t-on inviter ? Comment va-t-on innover la nourriture, le décor, les histoires, les invités, etc. ?
Et justement, quelle est la touche particulière de cette édition ?
Cette édition vient après une année de pause. Une année de pause parce qu’après cinq éditions, on voulait prendre un peu de recul pour revoir le modèle économique, le type de partenariat avec les sponsors. Puisqu’en général, ce que je trouve dommage, c’est qu’on a beaucoup d’entreprises qui, je le disais à la cinquième édition, nous regardent comme si les artistes venaient mendier pour leur événement. Alors que pour moi, quand on vient avec un dossier de sponsoring, avec un projet, l’entreprise a le choix. C’est-à-dire qu’on étudie le dossier, on trouve que l’entreprise peut associer son image à l’événement. C’est une relation de partenariat, donc on accompagne avec une certaine enveloppe. Ce n’est pas pour avoir 20 places ou 50 places.
Peut-être cela est dû au fait que certains promoteurs culturels, certains organisateurs, ont habitué les entreprises à cela. Donc moi, je disais que pour un événement comme la Grande Nuit du Conte, qui ne prend que 350 places, si j’ai 10 entreprises qui accompagnent et dont chacune demande 10 places, ça fait déjà un événement entre collègues. Est-ce que vous associez votre image à un événement pour venir entre collègues ? Vous voyez, c’était de revoir toutes ces questions et aussi de voir, même artistiquement, comment se renouveler.
On a utilisé du matériel depuis la première édition. Comment renouveler ce matériel pour que le décor change un peu, pour ne pas que les gens se lassent, qu’ils voient la même chose, les mêmes types de cases, les mêmes assises, les mêmes tables ? Comment renouveler tout ça ? C’est ce qui va être la nouveauté cette année.
Après, il y a des choses qui ne changent pas. On a les cases qui ne changent pas, on a les nattes, on a les cartas (clôture) qui font, mais ce sont les types de cases qui vont changer cette année. C’est le contenu artistique qui change chaque année.
Au-delà de cet événement et même de vos prestations aux quatre coins du monde, comment comptez-vous faire revivre le conte et peut-être même l’incruster dans la conscience collective ?
Je pense qu’à travers toutes les activités que nous faisons, nous commençons à impacter petit à petit, à interpeller et à nous installer un peu dans la tête des gens. Je pense que c’est ce qui va amener, par exemple, le ministère de l’Éducation à se dire : peut-être qu’il serait bien… Parce que ce qu’on dit souvent : on ne peut pas aimer ce qu’on ne connaît pas.
Le travail qu’on fait, c’est de faire découvrir ou redécouvrir ça à ceux qui le connaissaient. Et quand on connaît, on peut commencer à réfléchir, à dire : on aime ou on n’aime pas, ou on l’intègre dans telle chose ou pas.
On a un projet qui s’appelle le « conte comme outil pédagogique ». C’est un projet de sensibilisation et de formation des enseignants sur l’utilisation du conte comme outil pédagogique.
Au départ, nous sommes allés vers les écoles, mais elles n’ont pas été très réceptives. Peut-être parce qu’on a oublié ça, parce qu’on pense que c’est juste pour endormir ou pour distraire.
Mais au fil des ans, des écoles commencent à s’intéresser à nous et à nous inviter, même dans les cours de français, même dans des cours d’histoire ou de littérature. Je pense que c’est à travers toutes ces actions qu’on arrivera peut-être à changer la perception ou interpeller les gens sur le conte, sur l’intégration du conte dans différents domaines ou différentes activités.
Au-delà de tout ça, quels sont les autres projets ?
J’ai commencé un projet qui est un travail sur les jeux d’enfants. Je découvre encore une fois, à travers mes recherches, que les jeux d’enfants chez nous ne sont jamais fortuits.
Les jeux, c’est pour soit travailler l’intellect, soit travailler le physique. Les jeux, quand on prend, comme il y a un jeu qu’on appelle « Diba Mikondé », où, quand j’appelle mon ami par son prénom et qu’il répond, je remplis un gobelet d’eau, je lui donne, il boit. J’apprends que ça, c’est pour travailler le respect de la parole donnée.
Ou quand on a la corde et qu’on a deux équipes qui tirent, c’est pour travailler le physique, c’est pour travailler la solidarité, le travail en équipe, etc. Donc, ce travail, je suis en train de mener beaucoup de recherches là-dessus et aussi sur les comptines et les berceuses. Aujourd’hui, quand un bébé pleure, pour nous, jeunes parents, on va sur YouTube, on met des comptines européennes. Et donc l’enfant grandit avec ses comptines et donc grandit avec cette langue et ses codes. Je le dis souvent : une culture a son sens dans une langue.
Aujourd’hui, on remarque à travers les élèves qui viennent dans nos ateliers à Koumakan, que 80 % ou même plus d’enfants guinéens qui vivent en Guinée, qui étudient en Guinée, ne parlent aucune langue maternelle. Et ça, c’est dangereux.
Et à travers les écoles avec système français, donc les écoles françaises entre guillemets, ils ne connaissent presque rien de la Guinée. À ces enfants, on demande quelles sont les régions de la Guinée : il y en a qui disent Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Ils ne connaissent pas l’hymne national de la Guinée. Ils vivent en Guinée, mais ils connaissent l’hymne national de la France, « La Marseillaise ».
Ils connaissent Louis XIV, ils connaissent Napoléon. Et ce sont eux qui vont être les cadres de demain. C’est eux qui doivent construire la Guinée de demain. Mais ils ne connaissent rien de la Guinée, donc ils n’auront aucun sentiment, aucune attache.
On a beaucoup de jeunes aujourd’hui, de notre génération, qui disent : « Moi, je suis français ». Peut-être avec le passeport, oui. Mais en France, on va te dire : « les Africains ». Aux États-Unis, on va te dire : « les Africains », ou en Italie, etc. Il faut un grand travail de retour à nos sources, à nos valeurs culturelles.
C’est tout ça que je me donne comme projet. C’est énorme, je sais. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec une équipe. Et heureusement, c’est une équipe qui est aussi sensible à cela, qui est passionnée. C’est ce qui nous aide à avancer dans tout ce qu’on a entrepris depuis là.
Décryptage : N’Famoussa Siby